|
La cour de cassation a rendu cet arrêt dans une espèce dans laquelle le conducteur avait été relaxé au motif suivant : “s'agissant de la présence de cannabis dans la salive, l'expertise toxicologique, qui en fait état, ne mentionne pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'a été menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits.
9. Le juge en conclut qu'il résulte de ces éléments et des déclarations du prévenu, que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont établis avec certitude.” La cour de cassation reprend sa jurisprudence antérieure :
La cour de cassation précise tout de même : « l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants ». Il est donc légalement possible de vendre, acheter et consommer du CBD mais en revanche, interdit de conduire un véhicule après avoir consommé du CBD, puisque l’analyse salivaire ou sanguine risque de détecter le THC présent dans le CBD. Auquel cas, et même si le conducteur a consommé un produit légal, qui n’est pas classé comme produit stupéfiant, puisque dépourvu d’effet psychotrope, et ne présentant pas de risque pour la santé publique, il pourra être condamné pour conduite après usage de produits stupéfiants… Il reste à espérer, à défaut de recours devant la cour européenne des droits de l’homme, que les textes soient modifiés pour tenir compte de la légalisation de la vente et consommation de CBD, afin que l’obligation soit faite de mettre en place des tests permettant de distinguer la consommation de cannabis de la consommation de cbd, et ainsi autoriser uniquement la poursuite de consommateurs de produits stupéfiants. Les consommateurs de CBD, en cas de dépistage positif, peuvent solliciter, sur le lieu du contrôle, une contre-expertise par prise de sang, totalement gratuite. Il faudra, à cette fin, l’indiquer en cochant la case correspondante sur le formulaire de notification des droits qui est proposé à la signature sur le lieu du contrôle. La prise de sang se déroulera dans la foulée à l’hôpital en présence des enquêteurs. Source : Décision - Pourvoi n°22-85.530 | Cour de cassation
0 Commentaires
La cour de cassation confirme par cet arrêt que les dispositions, entrées en vigueur le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, supprimant la possibilité d’aménager les peines d’emprisonnement ferme supérieures à un an, ne peuvent s'appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur.
La chambre criminelle a en effet considéré : « 18. Jusqu’à présent la Cour de cassation a fait une distinction selon que la mesure d’aménagement avait été prononcée par le juge de l’application des peines ou par la juridiction de jugement. Elle a jugé que les premières ressortissaient aux lois d’exécution et d’application des peines (Crim., 9 juin 2010, pourvoi n°09-87.677) tandis que les secondes relevaient des lois de pénalité (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-85.387). 19. Cette distinction doit être abandonnée, dès lors que le législateur a réaffirmé le principe selon lequel la juridiction de jugement qui prononce une courte peine d’emprisonnement doit immédiatement envisager son aménagement. 20. Or, de quelque juridiction qu’elle émane, la décision portant sur l’aménagement se distingue de celle par laquelle la peine est prononcée. Les fins que l’une et l’autre poursuivent et les critères sur lesquels elles se fondent respectivement sont différents. 21. Aussi l’aménagement de peine constitue-t-il, même lorsqu’il émane de la juridiction de jugement, un dispositif relatif au régime d’exécution et d’application des peines. L’application dans le temps d’une telle mesure obéit par conséquent aux règles définies par l’article 112-2, 3°, du code pénal.» Cet article 112-2 détermine les règles applicables à l’application de la loi pénale dans le temps, la question étant de savoir si les dispositions nouvelles sont en l’espèce, ou non, immédiatement applicables. Il dispose : « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; 2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; 3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. » La chambre criminelle considère à juste titre que s’agissant de dispositions plus sévères que les anciennes, elles ne sont pas immédiatement applicables et ne peuvent être mises en œuvre que pour les infractions commises après leur entrée en vigueur, le 24/03/2020 : « 23. Tel est le cas des dispositions de la loi du 23 mars 2019 qui interdisent tout aménagement des peines d’emprisonnement sans sursis d’une durée comprise entre un et deux ans. 24. Il s’en déduit que ces nouvelles dispositions, plus sévères, ne sauraient recevoir application dans le cas d’espèce, s’agissant de faits commis avant leur entrée en vigueur. » SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2030_20_45736.html?fbclid=IwAR3ucgJ6K4WL-OeLLBDsrWiDWWOxW2OZnYrJkWVM-DKJaCPuuhOnXTJbnzI contestation des forfaits post-stationnement : le paiement préalable est contraire à la constitution9/10/2020 Par décision rendue le 9 septembre, le conseil constitutionnel considère non conformes à la constitution les dispositions de L'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant :
« La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis ». Pour le conseil constitutionnel, « le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. ». Ces dispositions contreviennent en effet à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, duquel il résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Cette déclaration d’inconstitutionnalité est effective dès maintenant. S0URCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020855QPC.htm Le Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifie les interdictions de déplacements, dans le cadre du plan de déconfinement :
" I. - Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants : 1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ; 3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ; 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ; 5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; 6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ; 7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise. II. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent. III. - Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur." De nouveaux modèles d'attestation ont été mis en ligne. A noter que les agents assermentés des services de transport peuvent dresser les contraventions lorsqu'elles ont lieu dans les transports publics. Les sanctions sont les mêmes que pour les amendes dressées dans le cadre du confinement à savoir : - une amende forfaitaire d'un montant de 135 € (contravention de la 4ème classe) - amende forfaitaire de 200 € en cas de violation réitérée en 15 jours (contravention de la 5ème classe) - délit réprimé de 3 750 € d'amende et de 6 mois de prison en cas de violation à 3 reprises en 30 jours. SOURCES : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14044 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/SSAZ2011695D/jo/texte https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-transport-et-environnement/Les-transports-du-quotidien/Deconfinement-les-attestations-pour-se-deplacer-dans-les-transports-en-commun-en-heures-de-pointe COVID-19 : les règles concernant les déplacements
|
ACTUALITÉ DU
|
|
DROIT
|
SOCIÉTÉ
|
|
|
~ 106 avenue Mozart 75016 PARIS ~
|
© COPYRIGHT 2017. ALL RIGHTS RESERVED
CRÉATION & GESTION : HL-COMMUNICATIONDIGITALE. |

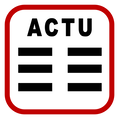
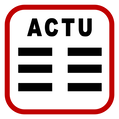
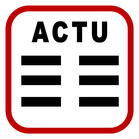
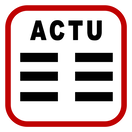

 Flux RSS
Flux RSS